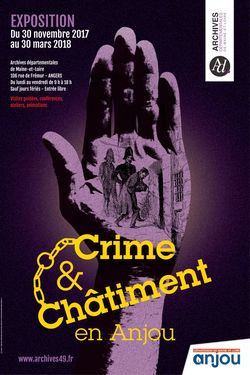
Le crime est en France, aux côtés de la contravention ou du délit, la plus grave des trois catégories d’infractions donnant lieu à poursuites pénales. Qu’il soit perpétré contre les personnes, contre les biens ou contre l’État, il est jugé en formation spécifique – la cour d’assises – et passible des plus lourdes peines, exclusivement de privation de droits et de liberté, la peine de mort et toutes peines corporelles ayant été peu à peu abolies.
Le mot « crime », issu du latin crimen, qui signifie « chef d’accusation, grief », apparaît en français au XIIe siècle. La définition du crime est alors large, et comprend autant les atteintes aux personnes et aux biens que les comportements réprimés par l’Église, comme l’adultère, l’usure, l’hérésie ou la sorcellerie. Par la suite, les définitions se précisent, et la codification du droit, notamment à l’époque napoléonienne, affecte aux termes un sens et une hiérarchie, qui s’inscrit également dans un ensemble de procédures visant à garantir l’égalité de tous devant la justice.
La nature et la gravité du crime, l’échelle des punitions appliquées à ceux qui s’en rendent coupables, sont donc le reflet des équilibres de la société dans laquelle se commettent les faits. Les archives judiciaires et pénitentiaires, présentes en grand nombre dans les fonds des Archives départementales, permettent d’illustrer ces enjeux sociétaux, éclairant la face sombre, mais intemporelle, de notre destin collectif.

Juger et punir
Sous l’Ancien régime, toute justice émane du Roi. Il n’est pas seul cependant à l’exercer. Le pouvoir de juger le crime est partagé avec les seigneurs « hauts justiciers », tant laïques qu’ecclésiastiques.
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, cette prérogative disparaît peu à peu, avec l’affirmation de la justice royale et la mise en place d’une hiérarchie de tribunaux qui exercent la justice « déléguée ».
Avec la Révolution, la justice est aux mains du peuple et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en affirme les grands principes. Le Premier Empire est pour le droit une période fondatrice, qui promulgue en 1808 le premier Code d’instruction criminelle, qu’appliqueront désormais les Cours d’assises. L’organisation actuelle en est la directe héritière.
La punition appliquée à l’auteur d’un crime doit être, sous l’Ancien Régime, exemplaire.
Ainsi, les condamnés font « amende honorable », se présentant pieds nus vêtus d’une chemise ; ils sont exposés à la vue de tous, sur le pilori ou l’échelle ; ils subissent des peines corporelles : nez, mains ou oreilles coupées, marques d’infamie des voleurs ou des condamnés aux galères.

À partir du XIXe siècle, le principe est celui de la proportionnalité de la peine. C’est cette recherche qui guide les jurés, lorsqu’à l’issue des débats contradictoires ils répondent aux questions de culpabilité, qui vont fixer le sort de l’accusé. La prison, notamment sous la forme de prison cellulaire, devient à partir du XIXe siècle la réponse pénale la plus courante. L’Anjou en garde de nombreuses traces, notamment avec la maison centrale de Fontevraud, active de 1804 à 1963. Elle peut s’accompagner d’éloignement, notamment dans les bagnes coloniaux de Guyane et Nouvelle-Calédonie.
Mais de tous temps la peine la plus grave reste l’exécution capitale.
Sous l’Ancien Régime la manière la plus courante de l’administrer est la pendaison, particulièrement pour les voleurs ; la décapitation est réservée aux nobles. Si le crime est très grave, le supplice est de mise : bûcher pour les sorciers, roue, écartèlement.
À partir du XIXe siècle, la guillotine, apparue sous la Révolution, est l’instrument du châtiment suprême. Elle fonctionnera en France pour la dernière fois en 1977.
Huit affaires criminelles
Du XVIe au XXe siècle, huit affaires criminelles ont été sélectionnées pour représenter la société de leur temps.
Affaire n° 1 - Mathurin Gruau, Condamné au bûcher pour sorcellerie
Saint-Denis-d’Anjou, 1508
Au mois de mai 1508, un procès criminel est instruit par les officiers de justice du chapitre Saint-Maurice d’Angers contre un habitant de Saint-Denis d’Anjou, près de Château-Gontier, alors situé dans le diocèse d’Angers. Un habitant, Mathurin Gruau, est accusé de sorcellerie. Il subit quatre interrogatoires.
D’abord il nie tout, puis ensuite se confesse et raconte son initiation : un jour l’épouse d’un nommé Chasseboeuf lui donne du beurre et des provisions dont il est incommodé. Il la soupçonne d’être en relations avec le diable et obtient d’elle la promesse d’être initié aux pratiques de sorcellerie et d’assister aux cérémonies du sabbat. Il se rend chez la femme. Elle le fait entrer, ils se mettent en chemise et s’enduisent le corps de graisse, puis ils prennent chacun un balai, font trois tours sous le tuyau de la cheminée, sortent par le conduit et errent dans la lande. Ils sont rejoints par des diables, l’un en habit noir, cornu et à poils longs, l’autre grand aux doigts crochus, et un dernier plus petit et sans cornes. Et il décrit un grand tumulte dans la lande, avec plusieurs prêtres, moines, clercs, hommes et femmes vêtus de robes, tandis que les assistants apportent des chandelles aux diables qui les allument, et leur prêtent hommage.
Il est probable que Mathurin Gruau cherche à détourner l’attention des juges de ses propres pratiques douteuses. Il n’évitera pas le châtiment réservé aux sorciers, périra sur le bûcher, et son corps sera « mis en cendres près de la justice patibulaire de Saint-Denis d’Anjou, ou l’on a coutume de faire de semblables exécutions ».
Affaire n° 2 - Michel BEUCHER, Gracié par le roi après une rixe mortelle
Angers, 1775
En novembre 1775, pour l’anniversaire de son sacre, le roi Louis XVI accorde par Lettres de rémission, la totale remise des accusations portées contre Michel Beucher, chirurgien à Angers, poursuivi pour avoir porté des coups mortels à un nommé Bodin, garçon épicier, dans les circonstances suivantes : le 26 mars 1762, étant alors garçon chirurgien en la ville d’Angers, il rencontra sur les neuf heures du soir, venant de voir ses malades, un nommé Bodin garçon épicier, avec Angélique Ferrand, fille d’un cordier de la ville. Comme ils paraissaient user d’une grande familiarité, il leur fit des « reproches sur leur indécence ». « Bodin, confus, se livra à la colère et porta plusieurs coups de bâton à Beucher. Celui-ci riposta et avec le sien renversa Bodin et se retira ». Bodin étant mort six jours plus tard, Beucher quitta Angers et n’osa revenir dans la ville. Profitant des mesures de clémence annoncées à l’occasion de l’anniversaire du sacre du roi, il se constitue prisonnier à Versailles, expose son affaire et obtient sa grâce.
Affaire n° 3 - Joseph VEYRENT et Arthur BLET, Acquittés après coups et blessures lors d’un duel
Saumur, 1854
Le dimanche 24 juillet 1853, quelques militaires et autres citoyens se trouvaient réunis au café de l’Hotel de ville à Tours. Une scène violente éclata à la suite de la chute d’un sous-officier qui avait provoqué quelques rires. Dans cette collision les accusés Veyrent, sous-officier et Blet, employé des chemins de fer échangent des mots de provocation, si bien qu’une rencontre fut fixée au lendemain. Blet, se disant l’offensé, avait eu le choix des armes et avait choisi le fleuret. Outre les quatre témoins, un groupe de spectateurs suivaient le combat. Veyrent fut bientôt touché au bras mais voulut continuer. Une seconde fois Blet toucha Veyrent également au bras. Aussitôt l’un des témoins somma les combattants de s’arrêter en criant « Assez, Halte » ! A ce signal, Blet abaissa son arme ; et, cessant alors de s’effacer, il présenta la poitrine de face à son adversaire. Mais ce dernier n’avait pas obéi au signal, et se fendant tout à coup sur Blet, il lui porta un coup qui le blessa grièvement. « Une rumeur de désapprobation éclata aussitôt parmi les assistants. Et Blet, irrité d’avoir ainsi été frappé sans défense, fit d’un coup violent sauter l’arme des mains de Veyrent et lui cingla les épaules du plat de son fleuret ». Les blessures de Veyrent sont sans gravité, celle de Blet lui cause « une incapacité de plus de 20 jours » et « plus élevée, eut pu être mortelle ». Le sort réservé aux deux hommes est intéressant. Ils sont d’abord traduits devant la Cour impériale de Poitiers qui refuse de poursuivre « au motif que, les faits constatés n’ayant eu lieu qu’après une convention de duel, et ce duel n’ayant été accompagné d’aucune déloyauté, les dits faits ne constituent ni crime, ni délit ». Mais l’arrêt est cassé. L’affaire est renvoyée devant la cour d’assises de Maine-et-Loire, sous le chef d’accusation de « tentative de meurtre avec préméditation, et coups et blessures volontaires, prémédités ». Les prévenus sont acquittés le 10 mars 1854.
Affaire n° 4 - 268 Insurgés de la Marianne, Jugés pour complot contre la sûreté de l’État
Maine-et-Loire, 1855
En septembre 1855, la cour d’assises de Maine-et-Loire est saisie de la célèbre affaire de la Marianne, cette société secrète infiltrée dans le milieu des ouvriers ardoisiers de d’Angers et de Trélazé. Nous sommes au début du second Empire. Louis-Napoléon Bonaparte assure son pouvoir de manière autoritaire, par le coup d’Etat du 2 décembre 1851 et la proclamation de l’Empire. Les opposants sont arrêtés, déportés ou proscrits, comme Victor Hugo. Une résistance diffuse, de courant pro-républicain et socialiste, se maintient cependant notamment au travers de sociétés secrètes. La Marianne est l’une d’elles. Présente dans le midi et le centre de la France, elle va toucher à Angers les artisans, aux Ponts-de-Cé et à Trélazé les ouvriers ardoisiers qui ont perdu de leurs prérogatives au profit d’entrepreneurs-exploitants qui représentent le capitalisme naissant. L’après-midi du dimanche 26 août 1855 le bruit circule qu’une manifestation est projetée pour marcher sur Angers. Des rassemblements s’organisent en soirée aux Ponts-de Cé, à Angers et à Trélazé. Les insurgés parviennent vers 4 heures du matin au faubourg Bressigny. Ils sont rapidement dispersés, aucun coup de feu n’est tiré. 133 personnes sont immédiatement arrêtées, 155 autres le lendemain grâce aux renforts dépêchés par Paris. 268 insurgés seront jugés, beaucoup bénéficient de non-lieux ou d’acquittement, mais 24 d’entre eux, considérés comme les meneurs, sont emprisonnés et déportés aux bagnes de Guyane, parmi lesquels Segretain, Attibert ou Pasquier. Le réquisitoire du procureur Métivier présente l’évènement comme une tentative de coup de force politique, et minimise les causes économiques de la révolte. Lorsqu’en 1859 l’empereur accorde l’amnistie aux condamnés politiques, les marianistes rentrent en Anjou. En 1860, le volet « carcéral » de l’affaire est terminé. Toutefois, l’affaire a marqué les esprits et la surveillance du milieu ouvrier demeure particulièrement forte.
Affaire n° 5 - François Gautier et Marie-Madeleine Hérissé, Condamnés à mort pour assassinat
Broc, 1873
Dans le village de Broc, près de Baugé, vivent Auguste Bruère, cordonnier, âgé de 26 ans et Marie-Madeleine Hérissé, 22 ans, son épouse. Le cordonnier est un homme estimé, qui vient de se voir confier la distribution du courrier postal de la commune. À la fin de l’année 1871, Auguste Bruère se lie d’amitié avec un garçon du pays, François Adrien Gautier, surnommé Isidore. Sans travail, l’homme est également sans logement et le ménage Bruère propose de l’héberger. Mais Isidore parvient bientôt à séduire l’épouse de son hôte, avec qui il entretient une relation passionnée. Auguste Bruère est bientôt mis au courant. Il chasse Isidore et lui interdit de revoir sa femme. Il l’enjoint de quitter le pays, mais celui-ci ne va pas bien loin. Palefrenier chez le marquis de La Poëze, il s’installe au château de Maulne, et reprend des relations suivies, épistolaires et secrètes, avec l’épouse infidèle. Bientôt, les amants élaborent un complot pour se débarrasser du mari gênant : Isidore devra attirer Auguste dans un guet-apens afin de l’assassiner. Pour ce faire, Marie confie à son amant la somme nécessaire à l’acquisition d’un révolver. Ils tentent à 5 reprises de passer à l’action, lorsque des moments propices se présentent, mais doivent renoncer, Auguste ne se présentant pas, pour diverses raisons, dans le lieu ou à l’heure envisagés. Enfin, le 23 septembre 1872, alors qu’Auguste regagne à pied le soir son domicile avec sa femme, Isidore peut mettre à exécution leur plan, tirant sur sa victime puis l’achevant de quatre coups de couteau. L’enquête met vite en lumière la moralité douteuse de l’épouse, et les amants ne tardent pas à passer aux aveux. Traduits devant la cour d’assises le 14 février 1873, ils sont reconnus coupables et condamnés à mort. Gautier sera exécuté le 15 avril1873, la peine de Marie Hérissé commuée en travaux forcés à perpétuité.
Affaire n° 6 - Jules Audigan, Fabrication et émission de fausse monnaie
Saumur, 1881
Dans le courant du mois de mars 1881, la police de Saumur fut avisée qu’un certain nombre de pièces fausses de 0,50 centimes et de 1 franc, à l’effigie de Napoléon III, circulaient chez les débitants et dans plusieurs magasins de la ville. Une enquête fut immédiatement ouverte et on acquit bientôt la certitude que ces monnaies avaient été mises en circulation par Audigan. On trouva à son domicile les débris de deux moules en plâtre qui avaient servi à fabriquer ces pièces, ainsi qu’une certaine quantité de métal semblable à celui dont elles étaient formées. En présence de cette découverte, Audigan fut obligé de faire des aveux. Il reconnut que, dans les derniers mois de 1879 et au début de 1880, il avait fabriqué, avec de l’étain, un certain nombre de pièces de 50 c. et de pièces de 1f. Il avait ensuite écoulé toutes ces monnaies au fur et à mesure de ses besoins, chez les habitants et dans les magasins de Saumur. Trois de ces pièces seulement ont pu être retrouvées et saisies par la police, une de 50 c. et une de 1f. Mais Audigan lui-même reconnait en avoir fabriqué et mis en circulation un nombre beaucoup plus considérable, une cinquantaine de 50c. et une trentaine de 1f., crimes punis par les articles 132 et 164 du code pénal. L’accusé n’a pas d’antécédent judiciaire. Le ministère public souligne que « sa conduite laissait à désirer, puisqu’il s’était déjà rendu coupable d’un vol de vin pour lequel il était renvoyé devant la juridiction correctionnelle ». Jules Audigan a été déclaré coupable avec circonstances atténuantes le 12 mai 1881 et condamné à 5ans de réclusion et 100 francs d’amende.
Affaire n° 7 - Marie-Perrine Salliot, Condamnée pour infanticide
Loiré, 1883
Marie-Perrine Salliot est née à Ballots (Mayenne) le 26 décembre 1866. Au mois de juin 1880, elle entre au service de Melle de Lesperonnière, au château des Noyers à Loiré. Au mois de mai 1882, « cette fille, de moeurs dissolues, se livra spontanément à un journalier qui fréquentait le château, et ne tarda même pas à avoir un second amant, avec lequel elle ne rougit pas d’avoir des relations intimes en présence du premier. Devenue enceinte, elle dissimula sa grossesse avec le plus grand soin, et ne fit aucun préparatif pour recevoir son enfant ». L’accouchement se présente dans la matinée du 20 juin 1883. Elle prétexte des coliques et se retire dans sa chambre. Dans l’après-midi, ses douleurs augmentant, la femme de chambre du château reste auprès d’elle pour lui donner des soins. Vers six heures du soir, cette dernière quitte la chambre pendant environ un quart d’heure. À son retour, elle constate que le parquet est taché de sang. Le docteur Thuau, médecin de famille, alerté par Melle de Lesperonnière, se présente. Il se rend compte qu’il a affaire à un accouchement. Observant une tache de sang près d’un placard, il y découvre, « enveloppé dans des chemises de femme, le cadavre d’un enfant de sexe masculin ayant le cou presque entièrement tranché ». La domestique passe alors aux aveux, et est traduite devant la cour d’assises de Maine-et-Loire. Elle est jugée le 8 août 1883, et reconnue coupable d’infanticide, avec circonstances atténuantes. Elle est condamnée à 5 ans de travaux forcés.
Affaire n° 8 - Paul Poignault, Condamné à la déportation pour meurtre et tentative de meurtre
Angers, 1927-1928
Paul Poignault, âgé de 41 ans en 1926, est chiffonnier à Angers dans le quartier de la Doutre. Il vit depuis quelques années avec Louise Bézard, dont il a deux enfants. C’est un homme violent qui depuis sa jeunesse multiplie les condamnations et séjours en prison. Au début de 1927, il entre en conflit avec d’autres chiffonniers, notamment les époux Laisis et Jules Passelande, dont il décide de se venger. Le 10 janvier 1927, il achète un révolver et des cartouches, et dans la soirée, va se poster sur le chemin de ses ennemis. Il tire deux coups de révolver sur Jules Passelande et le blesse grièvement. Quand Henriette Passelande (épouse Laisis) accourt au secours de Jules, son frère, Paul Poignault tire sur elle un coup de révolver qui la blesse mortellement.
Condamné le 18 mai 1927 à la peine de travaux forcés à perpétuité par la cour d’assises de Maine-et-Loire, Paul Poignault est détenu à la prison d’Angers, où il reçoit régulièrement la visite de son ancienne maîtresse, Louise. Il souhaite l’épouser, mais l’administration refuse. Le 15 octobre 1927, à la fin d’une visite au parloir, Paul Poignault lui enfonce un couteau dans la poitrine mais, sentant qu’elle est blessée, elle fait un mouvement qui empêche la lame de pénétrer plus avant. Paul Poignault reconnaît avoir eu la ferme résolution de la tuer parce qu’il la tient pour responsable de la mort de leur second fils, survenue le 2 août 1927. Il indique que depuis cet événement, il lui voue une haine féroce. Le 14 février 1928, la cour d’assises de Maine-et-Loire le condamne, une seconde fois, aux travaux forcés à perpétuité pour tentative d’assassinat. Considéré comme très dangereux, il est envoyé le 6 juin 1928 à la maison centrale de Fontevraud. Transféré le 20 octobre à Saint-Martin-de-Ré, il est embarqué le 8 novembre 1929 sur la Martinière, navire-prison à destination de Cayenne. Il s’évade le 16 juillet 1930 mais est repris et réintégré au bagne le 8 décembre 1930. Il meurt à Saint-Laurent-du-Maroni le 7 janvier 1942, âgé de 57 ans.


